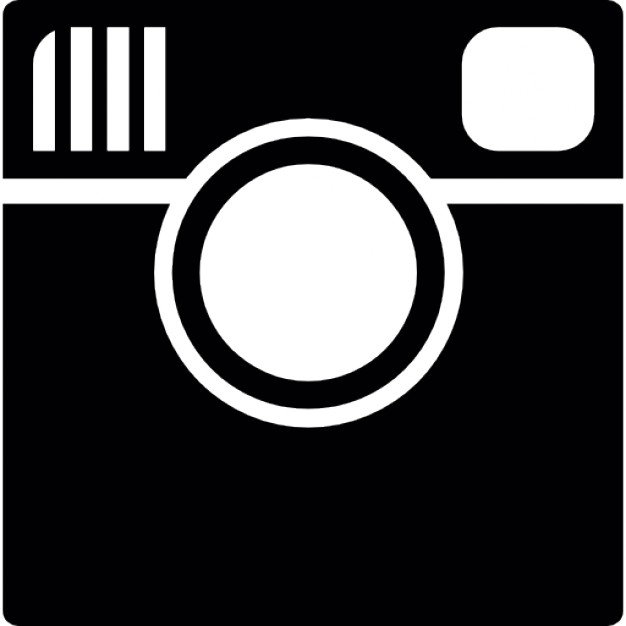Antonio Tagliarini
Au croisement des pratiques de plateau, puisant aux sources de la littérature, de la sociologie et de la philosophie, le duo de performeurs et metteurs en scène italien Daria Deflorian et Antonio Tagliarini collaborent depuis 2008 à rendre visibles les vies minuscules enfouies dans les limbes du quotidien. Pièce après pièce, ils tentent de cerner le mal-être de notre société contemporaine, ménageant un espace de visibilité aux êtres fragiles qui peinent à se mettre en phase avec l’urgence du monde capitaliste.
Après la modeste femme au foyer de Reality (2012) et les retraitées grecques de Nous partons pour ne plus vous donner de soucis (2013), leur dernière création tisse sa fine toile dramaturgique autour du personnage mélancolique et enfantin de Giuliana, incarné par Monica Vitti dans le film culte d’Antonioni Le Désert rouge (1964). La référence au film hante le discours et les fêlures qu’il énonce, mais la pièce compte cinq interprètes — trois femmes, deux hommes — pour dépasser le triangle amoureux bourgeois et incarner librement la figure de Giuliana, à laquelle chacun s’identifie. Quelques fragments de textes, des bribes de confidences tristes qui font rire, des chansons : par petites touches, ces figures solitaires et fragiles nous racontent leur inadéquation. Avec ses moments de vulnérabilité, ses accès de rage et de sincérité Quasi niente est une pièce désespérément comique et paradoxalement lumineuse.

Production A.D., Teatro di Roma – Teatro Nazionale, Teatro Metastasio di Prato, Emilia Romagna Teatro Fondazione Coproduction Théâtre Garonne, Scène européenne – Toulouse, Romaeuropa Festival, Festival / d’Automne à Paris, Théâtre de la Bastille – Paris, Luganoinscena LAC / Théâtre de Grütli – Genève, La Filature Scène nationale – Mulhouse / Avec le soutien de Institut Culturel Italien de Paris, l’Arboreto – Teatro Dimora de Mondaino, FIT Festival – Lugano / Création janvier 2020 au Théâtre de Lorient - CDN
Au croisement des pratiques de plateau, puisant aux sources de la littérature, de la sociologie et de la philosophie, le duo de performeurs et metteurs en scène italien Daria Deflorian et Antonio Tagliarini collaborent depuis 2008 à rendre visibles les vies minuscules enfouies dans les limbes du quotidien. Pièce après pièce, ils tentent de cerner le mal-être de notre société contemporaine, ménageant un espace de visibilité aux êtres fragiles qui peinent à se mettre en phase avec l’urgence du monde capitaliste.
Après la modeste femme au foyer de Reality (2012) et les retraitées grecques de Nous partons pour ne plus vous donner de soucis (2013), leur dernière création tisse sa fine toile dramaturgique autour du personnage mélancolique et enfantin de Giuliana, incarné par Monica Vitti dans le film culte d’Antonioni Le Désert rouge (1964). La référence au film hante le discours et les fêlures qu’il énonce, mais la pièce compte cinq interprètes — trois femmes, deux hommes — pour dépasser le triangle amoureux bourgeois et incarner librement la figure de Giuliana, à laquelle chacun s’identifie. Quelques fragments de textes, des bribes de confidences tristes qui font rire, des chansons : par petites touches, ces figures solitaires et fragiles nous racontent leur inadéquation. Avec ses moments de vulnérabilité, ses accès de rage et de sincérité Quasi niente est une pièce désespérément comique et paradoxalement lumineuse.
Un projet de Daria Deflorian et Antonio Tagliarini / Librement inspiré du film Le Désert rouge de Michelangelo Antonioni / Collaboration à la dramaturgie et assistanat à la mise en scène Francesco Alberici / Avec Francesca Cuttica, Daria Deflorian, Monica Piseddu, Benno Steinegger, Antonio Tagliarini / Collaboration au projet Francesca Cuttica, Monica Piseddu, Benno Steinegger / Conseiller artistique Attilio Scarpellini / Texte Bon à rien de Mark Fisher / Lumière et espace Gianni Staropoli / Son Leonardo Cabiddu / Musique live par le groupe Wow Domani de Franco Fanigliuolo, Niente di speciale et Come la notte de Leonardo Cabiddu et Francesca Cuttica, musique Il surf della luna de Giovanni Fusco / Costumes Metella Raboni / Direction technique Giulia Pastore / Organisation Anna Damiani / Accompagnement et diffusion internationale Francesca Corona avec Giulia Galzigni, L’Officina / CRÉDITS PHOTOS CLAUDIA PAJEWSKI, LUCA DELPIA
Daria Deflorian et Antonio Tagliarini partagent avec une poignée d’artistes italiens de la scène indépendante des projets collectifs et une tournure d’esprit frondeuse qui n’attend pas la poussée des vents dominants. Ensemble, ils créent une série de projets dont ils sont à la fois auteurs et performeurs. Provenant du monde de la performance, ils recherchent d’autres modes de représentation et explorent des formes alternatives d’alliance entre la scène et le public.
Leur collaboration artistique s’amorce en 2008 autour du spectacle Rewind, en hommage au mythique Café Müller de Pina Bausch, créé au Festival Short Theatre de Rome et présenté dans plusieurs festivals italiens et européens. Auteurs, acteurs et metteurs en scène, le tandem valorise des processus entre enquête et recherche théâtrale. Ils créent From A to D and Back Again (2009) inspiré d’Andy Warhol. En 2010, ils découvrent l’inventaire de la vie intime de la Polonaise Janina Turek, point d’impulsion du Progetto Reality dont sont issus Czeczy/cose (2011) une installation/performance et Reality en 2012. À l’automne 2012, ils sont invités par le Teatro di Roma pour intégrer le projet Perdutamente dans lequel ils créent Ce ne andiamo per non darvi altre preoccupazioni, (décembre 2012). Cette création constitue la première étude du spectacle qui a débuté au Festival Romaeuropa en novembre 2013 et dans lequel, avec les deux auteurs sur scène, on retrouve Monica Piseddu et Valentino Villa. À l’automne 2016 ils créent Il cielo non è un fondale au Théâtre de Vidy-Lausanne où c’est le paysage à être protagoniste et, toujours, la question du réel et de sa représentabilité dans l’art et en particulier au théâtre. L’objet de leur nouveau projet est Le désert rouge, ce film extraordinaire de Michelangelo Antonioni qui a comme protagoniste suprême le paysage, dans un monde où maladie et beauté se confondent. De cette dernière recherche sont issus la performance Scavi et le spectacle Quasi niente.
Quasi niente, trois visages d’un même spleen
Les metteurs en scène italiens Daria Deflorian et Antonio Tagliarini montrent l’héroïne dépressive du Désert rouge d’Antonioni à divers âges de sa vie, incarnés par trois comédiennes.
On peut avoir tout oublié d’un film mais se souvenir de la distance entre les personnages et être resté sensible à la chorégraphie de leurs déplacements comme à leur élégance. On peut être incapable de narrer son histoire, ne plus du tout savoir de quoi il retourne, mais avoir gardé trace de ce qui ne se laisse pas nommer. Le Quasi niente (presque rien) des Italiens Daria Deflorian et Antonio Tagliarini s’inspire ainsi de la substance du film le Désert rouge de Michelangelo Antonioni pour une libre adaptation sur un fil. Il n’y a pas de Monica Vitti ici, mais trois femmes de générations différentes - la même à plusieurs âges de sa vie, sans que cela ne soit appuyé ou franchement énoncé - qui évoquent l’actrice et son rôle, se projettent en elles, et tentent de dire leur difficulté d’être.
Les deux hommes sont au second plan, plus inconsistants même quand rien ne leur interdit de prendre le plateau. Est-ce dû à la puissance des trois comédiennes - Francesca Cuttica, Monica Piseddu, Daria Deflorian - ou à une intention ? On se souvient alors que l’un des derniers films d’Antonioni, qui aurait pu être le titre générique d’une partie de son oeuvre, s’appelle Identification d’une femme.
Un rectangle gris en tulle tamise les silhouettes lorsque les cinq acteurs apparaissent sur le fond du plateau un à un, tandis que les spectateurs s’installent. Puis, vite, sur le devant, un fauteuil en cuir rouge, trouvé dans la rue. Le genre de meuble qui vous suit toute une vie, de déménagement en déménagement. Une armoire sans porte. Une commode à multiples tiroirs. Un minuscule transistor à l’avant-scène d’où émerge une ritournelle basse. Voilà pour le décor, qui suffit à donner les couleurs d’une existence quand tout le reste a été balancé.
La sexagénaire (Daria Deflorian, qui cosigne la mise en scène) se lance. Elle n’a pas les mots, elle ne les a jamais eus, ils s’arrêtent derrière ses lèvres. Elle n’a jamais pris place dans sa propre vie. Mais elle a ce fauteuil, sur lequel elle vient s’asseoir. Le talent de l’actrice est d’insuffler de la vitalité et de la drôlerie à des propos qui pourraient mourir d’atonie. Cependant, pourquoi devrait-on sauter de joie lorsqu’à chaque réveil on se demande s’il vaut mieux commencer par s’étirer ou chauffer un verre d’eau tiède conseillé par le médecin ? « Les gens pensent que la gymnastique règle tous les problèmes. "Ça ne va pas ? Fais un peu d’exercice. Achète-toi au moins un petit tapis." Avant, on pensait que c’était le sexe qui réglait tous les problèmes. » Rire de la salle dont le public s’adonne sans doute à cette croyance. La cadette s’avance et lui demande frontalement si elle peut prendre sa place. C’est le rôle des cadettes, même lorsqu’elles sont une partie de soi, à la manière d’une poupée russe.
Ce qui frappe est l’écoute active des partenaires immobiles, constamment sur le plateau, leur ultraprésence discrète. La solitude est peuplée et la non-communication, un genre de leurre. Finalement, on est toujours écouté. Il y a de la délicatesse dans les teintes des costumes qui déclinent l’automne de chaque vie, et dans la synchronisation des gestes qui ne miment pas le réalisme mais la souplesse d’un pas de danse. Parfois, les paroles de la plus jeune mutent en chanson dans une transition si imperceptible qu’on ne s’en aperçoit d’abord pas. Du play-back ? Erreur. Les musiciens qui l’accompagnent sont en coulisse, et c’est bien l’actrice Francesca Cuttica qui chante ici et maintenant, dans ce spectacle, ode au non-virtuel, bien que nombre de fantômes surgissent.
Anne Diatkine, Libération.fr le 25 octobre 2018.
Théâtre : ces "presque rien" qui font la vie
Daria Deflorian et Antonio Tagliarini font du Désert rouge, d’Antonioni, la trame noire de leur spectacle.
Que ceux qui n’avoueront jamais avoir douté d’eux lèvent la main. Et filent séance tenante au Théâtre de la Bastille. Quasi niente est fait pour eux. Ils y découvriront ce qui se cache sous le tapis d’une réalité moins souriante qu’il n’y paraît. La conviction de n’être rien, ou presque rien, voilà l’essence de cette représentation. Ce sentiment n’est pas contagieux. Le confesser n’implique pas de s’anéantir et en prendre acte réactive cette valeur peu prisée qu’on appelle l’empathie.
Sur le plateau chichement investi d’une commode de bois clair, d’un fauteuil de skaï rouge, de trois chaises en plastique, d’une armoire désossée et d’un terne tulle gris, il n’est pas donc question de faire comme si tout allait pour le mieux dans un monde parfait. Bienvenue chez les antihéros du XXIe siècle. Ils ont de 30 à 60 ans. La sensation de la défaite, le chagrin et la mélancolie n’épargnent aucun âge de la vie. Les cinq individus en place sur ce pauvre plateau ne sont pas à la mode dans le paysage actuel qui préfère les vainqueurs aux perdants. Pourtant, leur monde intérieur n’a rien d’un vide abyssal. Ce serait même plutôt l’inverse.
On connaît depuis 2015, date de leur apparition en France au Théâtre national de la Colline, Daria Deflorian et Antonio Tagliarini. Ces artistes italiens n’enveloppent pas de paillettes les malaises des sociétés modernes. S’ils font du théâtre, c’est pour libérer les taiseux du mutisme et donner un corps à ceux que laisse sur le carreau un libéralisme arrogant et prônant la feinte décontraction, même au plus fort de la dépression. Leurs spectacles se passent du ronflant des discours et font l’économie de décors tapageurs. Ils ne se préoccupent que de l’humain. Pour cette raison, les acteurs y sont très attachants.
Quasi niente est une tribune dédiée à ceux pour qui rien ne va de soi. Le bonheur, l’inscription sereine dans le flux du quotidien, la relation à l’autre : que se passe-t-il quand tout en nous s’effrite ? En toile de fond plane l’ombre du film d’Antonioni Le Désert rouge (1964). Référence du cinéma de la Nouvelle Vague, il est la trame qui obsède les protagonistes. Avec lui surgit par intermittences la figure hagarde de Giuliana, une bourgeoise qui erre dans la plaine du Pô et se débat pour y voir clair. Incarnée à l’écran par Monica Vitti, cette femme à la dérive ne sait plus comment accorder son pas à la marche du réel : « Il y a quelque chose d’épouvantable dans la réalité et je ne sais pas ce que c’est. » Les mots prononcés par l’actrice sont cités textuellement par l’un des comédiens, mais chacun pourrait les reprendre à son compte.
Qu’est-ce que la réalité ? Ce qu’on nous donne à voir ou ce qui se dissimule derrière ce qu’on nous donne à voir ? Le spectacle, finement tricoté par les interprètes, lève le voile sur l’apparence. Plutôt que d’aller de la surface trompeuse vers le noyau obscur où loge la vérité, il part de ce noyau pour revenir vers la surface. Deux hommes, trois femmes nous racontent par petites touches pourquoi ils boitent, vacillent et sombrent. C’est « presque rien » (quasi niente). Ça prend la forme de confidences tristes qui font rire, de chansons douloureuses, d’un geste de danse qui avorte, de détails insignifiants et de souvenirs d’enfance obsédants. Autant de petites molécules insolubles qui font de nous des êtres vivants.
La représentation s’achève par la mue du décor. De pauvre, gris et nu, il se métamorphose en foyer chaleureux, avec photos de famille, livres entrouverts, plaid moelleux et tapis coloré. On dirait une image d’Epinal qui raconterait un monde parfait. Sauf que les acteurs ont disparu derrière le tulle opaque. Et que personne ne vit dans un monde parfait.
Joëlle Gayot, Lemonde.fr, le 25 octobre 2018.
Presque rien.
Giuliana, épouse et mère, traverse le désert – vraiment rouge dans l’une des séquences – de sa vie sans que personne ne puisse réellement la toucher, sans non plus toucher personne. Un court-circuit de sens et sensations qui encore aujourd’hui nous trouble. Un objet encombrant, vu, discuté, disséqué.
À la différence de Janina Turek, la protagoniste du travail que nous avons réalisé en 2012, Reality, et des retraitées grecques de Petros Markaris dans les habits desquelles nous nous sommes glissés dans Nous partons pour ne plus vous donner de soucis en 2013, deux sujets dont peu de gens voire personne ne s’étaient emparés, Le Désert rouge est en revanche l’une des oeuvres majeures – a t-on pu lire – non seulement du cinéma italien et international mais aussi des arts visuels du vingtième siècle. Nous avons fait le choix d’être cinq sur scène, trois femmes, deux hommes. Tout d’abord pour éviter le triangle amoureux bourgeois, femme-mari-amant, puis pour avoir la possibilité de travailler librement autour de la figure de Giuliana et enfin, pour répondre à la tension antiréaliste du film. En effet, si cette oeuvre nous a touchés c’est aussi parce que le film n’est pas son intrigue et ceci nous correspond bien. Depuis toujours dans nos créations, nous sommes attirés par des figures marginales, humbles (ces lucioles physiques et de pensée si bien mises en valeur par Georges Didi-Huberman), depuis toujours nous nous décrivons dans leurs chutes et leurs échecs. Figures en apparence éloignées du cinéma de Antonioni et du milieu de la moyenne bourgeoisie où se situent ses films. En réalité, Giuliana fait pleinement partie de cette galerie de personnes bancales, à moitié accomplies. C’est une "sauvage vêtue élégamment", une Kaspar Hauser à sa façon. Quelque chose chez Giuliana nous parle d’une recherche de vérités que souvent, dans notre "capacité" toujours croissante d’être au monde, nous avons perdue. Nous nous sommes adaptés. Bien installés, nous avons tu des questions semblables à celles que Giuliana se pose : "Que dois-je faire de mes yeux ? Regarder quoi ?".
Notre travail veut porter non seulement sur le mal-être, la fragilité, les fêlures, mais aussi sur la part d’enfance d’une femme, que le monde ne semble plus intéressé à écouter. "Il y a quelque chose de terrible dans la réalité, et je ne sais pas ce que c’est. Et personne ne me le dit" dit Giuliana. Désert rouge s’interroge de manière très personnelle sur ce changement historiquement important que tous les artistes de l’après-guerre ont éprouvé et raconté : dans le cas d’Antonioni on a parlé d’aliénation, Pasolini l’appelait ouvertement génocide culturel. Cette aliénation – terme désuet mais ce n’est pas fortuit – nous appartient tellement que nous ne sommes même plus capables de la ressentir. La charnière entre le dedans et le dehors dans cette oeuvre est si ténue que l’on ne peut être que soulagés par le fait que le film commence pendant une grève et qu’il y ait en toile de fond l’exploitation d’ouvriers appelés à quitter leurs terres pour partir travailler à l’étranger. L’osmose entre les deux niveaux du récit chez Antonioni ne se veut ni idéologique ni résolutive, mais elle creuse, entremêle, déplace. Nous voilà de nouveau confrontés au rapport entre figure et toile de fond auquel nous nous sommes mesurés dans Le ciel n’est pas une toile de fond (2016).
Où sommes-nous à présent ?
C’est à cet endroit que Quasi niente (Presque rien) évoque la distance qui nous sépare du film Le désert rouge. Comme si nous étions tous Giuliana mais, qu’au même moment, personne ne l’était plus. Plus que malades en tant qu’individus, nous le sommes en tant que société et sans cette marge d’imagination (derrière notre rêverie, il y a le monde entier a pu écrire Antonioni dans une lettre à Mark Rothko) qui fait de Giuliana la figure la plus vraie, la plus singulière, la plus vivante du film. À présent, nous nous trouvons dans un monde qui semble avoir parfaitement accompli la parabole du mal-être, en la rendant même positive et insurmontable. Monde qu’un jeune théoricien de la culture, Mark Fisher, a défini comme celui du "réalisme capitaliste". Un réalisme qui ne ressemble pas aux autres : c’est un réalisme complet, sans porte ni fenêtre, qui a préalablement exclu toute autre vision du monde, subsumé tout passé, hypothéqué tout futur. Mais c’est justement cela l’enjeu marginal du théâtre : continuer à faire entrevoir le "monde entier" derrière une impuissante rêverie et les limites de "ce monde" derrière la puissance avec laquelle il écrase chacun.
Daria Delforian & Antonio Tagliarini